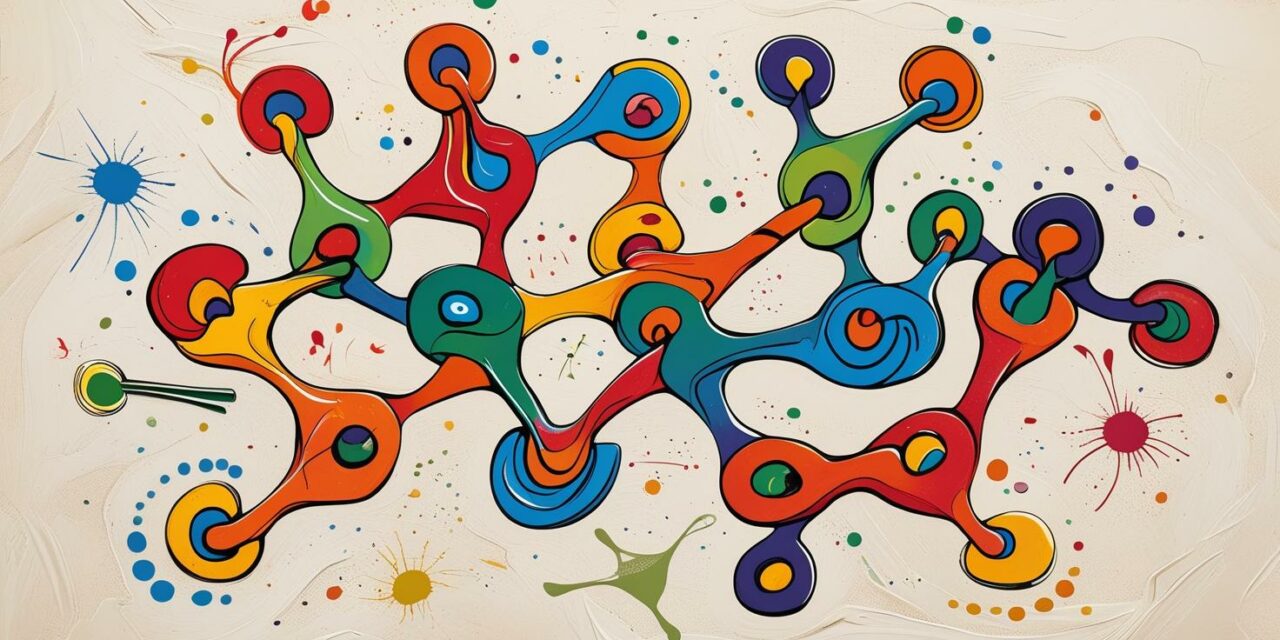J’avais écrit sur la transformation digitale et ses effets sur la gestion de l’information et de la relation. Aujourd’hui je m’intéresse à la manière dont la prise en compte des liens au travail, ces fils qui tissent nos relations professionnelles, peuvent guider les choix et les usages des systèmes d’intelligence artificielle.
Les bénéfices humains et sociaux des technologies IA sont appréciés différemment selon les individus, leurs attentes et leurs besoins au travail. Mais ils dépendent surtout de :
– L’attention portée par l’entreprise à leurs effets sur les liens, et donc sur les relations humaines qui en découlent.
– La cohérence entre les choix et les conditions concrètes de leur mise en œuvre.
1. Les liens au travail que les systèmes d’IA peuvent transformer silencieusement
Pour conduire cette analyse, j’ai retenu 7 liens sur lesquels se construisent et se combinent, encore aujourd’hui, les relations professionnelles dans un contexte salarial :
– Lien économique
– Lien hiérarchique
– Lien normatif
– Lien identitaire
– Lien social
– Lien psychologique
– Lien contractuel
Les systèmes d’IA tendent à réduire, intensifier ou à déplacer les liens, et modifient en conséquence les relations au travail.
Quelques illustrations pour chacun de ces 7 liens :
– Lien économique : En première intention, l’IA vise très souvent à optimiser les coûts, la productivité. Soit l’entreprise ne valorise plus que la valeur produite par le salarié en interaction avec le système, soit elle supprime des emplois.
- Un analyste financier utilise une IA pour générer des rapports. Le temps passé à les produire n’est plus valorisé, seule la qualité des analyses issues de cette collaboration le sont.
- Un service client partiellement automatisé accroît la disponibilité 24/7 mais réduit les effectifs.
– Lien hiérarchique : L’IA délègue le pilotage à la machine.
- Une IA de planification impose des plannings à une équipe sans échange avec le manager.
– Lien normatif : Les règles sont intégrées directement dans les systèmes d’IA, de façon explicite ou non.
- L’IA impose une évaluation standard de la performance via des KPI, au détriment d’une appréciation partagée entre le collaborateur et le manager.
– Lien identitaire : l’IA prend le relais sur des tâches à forte valeur identitaire.
- Une IA de conception valide, modifie ou oriente systématiquement les choix techniques d’un ingénieur. Il a le sentiment que son expertise est dévalorisée. Cela affecte son sentiment d’appartenance.
– Lien social : Les échanges entre salariés sont dématérialisés et automatisés.
- Les demandes de support ou de coordination passent uniquement par des plateformes ou assistants automatisés, ce qui appauvrit les liens de proximité, réduit le partage d’informations et de connaissances, ainsi que le collectif de travail.
– Lien psychologique : L’IA automatise les décisions individuelles.
- Lorsqu’une IA répartit la charge de travail sans tenir compte des situations individuelles et sans dialogue, cela détruit les engagements implicites, la confiance et le sentiment de sécurité.
– Lien contractuel : L’usage des dispositifs IA crée des flous sur les responsabilité et soulève des questions nouvelles sur les droits numériques.
- Qui est responsable d’une erreur commise sur la base de la recommandation d’un dispositif d’IA ?
- Peut-on utiliser es données produites par un salarié pour entraîner une IA sans son accord ?
Les relations humaines au travail sont souvent un angle mort des stratégies technologiques — et pas seulement technologiques. L’introduction de systèmes d’intelligence artificielle ne transforme pas seulement les tâches et les processus : elle modifie en profondeur la nature des liens sur lesquels se construisent les relations de travail.
Il devient alors essentiel de se poser les questions suivantes :
– Quels liens voulons-nous préserver, et pourquoi ?
– Quels nouveaux liens émergent avec l’IA ?
– Lesquels sont cohérents avec notre modèle économique et notre modèle social ?
Chaque entreprise ne valorise pas les mêmes liens au travail : cela tient à sa culture métier, à l’histoire de l’organisation, ou encore aux convictions de ses dirigeants.
Certaines privilégient des liens normatifs forts (cadres stricts, conformité), d’autres misent sur les liens sociaux ou identitaires (culture collaborative, valeurs partagées).
Les entreprises ont tout intérêt à définir une stratégie IA en cohérence avec leur identité culturelle car un système d’IA n’est pas neutre.
Il peut renforcer certaines logiques (contrôle, compétition, efficacité) et en affaiblir d’autres (autonomie, solidarité, reconnaissance).
Par exemple, une entreprise qui valorise l’autonomie ne déploiera pas une IA de micro-surveillance. Ou une organisation attachée au lien hiérarchique pourra intégrer une IA d’aide à la décision, à condition que les responsabilités restent clairement assumées par les managers.
2. Ancrer sa stratégie IA dans la réalité du travail et des relations de travail
Les analyses et les décisions liées à l’automatisation du travail en utilisant des dispositifs IA ne peuvent être conduites sans impliquer les personnes concernées.
Pour qu’un système d’IA soit pertinent, accepté et durable, il doit s’appuyer sur une démarche participative structurée, qui place les salariés au cœur des processus d’évaluation des besoins, de choix et de décisions.
Concrètement, cela implique de :
– Associer les salariés dès l’amont, en identifiant avec eux les opportunités d’automatisation susceptibles d’améliorer concrètement leur travail et les collaborations, et en les associant aux tests et aux choix des dispositifs techniques.
– Développer un dialogue régulier pour recueillir les ressentis, débattre des usages, faire évoluer les pratiques.
– Intégrer des indicateurs qualitatifs en cohérence avec les liens et les valeurs définis dans le pilotage global de la stratégie IA.
La démarche suppose de consacrer du temps productif à l’écoute, à l’échange et à la co-construction.
Pour beaucoup d’entreprises, l’ampleur de cette démarche participative peut constituer un obstacle infranchissable à l’exploitation de ces technologies.
Mais c’est aussi ce qui permet – comme dans tout projet de transformation – de renforcer l’adhésion, la confiance, et de favoriser une mise en œuvre plus fluide.
En impliquant les salariés dès les premières étapes, l’entreprise ne se contente pas d’accompagner le changement :
- elle ancre sa stratégie IA dans la réalité du travail, des conditions de travail, des relations de travail.
- selon le point de départ, elle préserve et enrichit sa culture.
En retour, l’entreprise augmente ses chances de créer une valeur durable, à la fois économique et sociale.
3. IA : une nouvelle opportunité de repenser la relation Employeur-Employé
Les changements portés par les technologies et les usages des IA peuvent créer un sentiment profond de perte de repères, mais ils ouvrent aussi de nouvelles possibilités.
La relation Employeur–Employé pourrait se recomposer autour de trois principes :
– La réciprocité de la valeur créée : Si l’IA permet à l’entreprise d’optimiser son activité, elle doit aussi permettre aux salariés de mieux travailler, de gagner en autonomie, de développer leurs compétences, d’en acquérir de nouvelles.
– La reconnaissance des personnes : Dans un environnement où certaines tâches sont automatisées, il devient essentiel d’expliciter et de valoriser davantage le travail humain.
– La co-construction : Face aux risques de déshumanisation ou d’opacité, impliquer les salariés dans les choix technologiques, les règles d’usage, les ajustements et la gestion des compétences devient un impératif de confiance.
Cela suppose de répondre à ces questions :
– Comment maintenir ou développer l’intérêt du travail, au-delà de l’efficacité ?
– Quelle autonomie voulons-nous préserver ou développer ?
– Quelle place donnons-nous à l’humain dans les décisions ?
– Comment garantir l’équité, la transparence et la confiance dans un environnement partiellement automatisé ?
– Quelles compétences doivent être développées et comment ?
– Quel est le rôle de l’entreprise dans l’employabilité individuelle ?
– Comment préserver un sentiment de sécurité dans un contexte technologique évolutif ?
Autant de sujets qui invitent à redéfinir une nouvelle relation Employeur–Employé, un nouveau pacte social adapté à un contexte de mutations économiques, technologiques et sociales.
Plus encore que lors des précédentes révolutions technologiques, l’intensification de l’automatisation rend indispensable la définition claire et assumée du Projet Humain de l’entreprise et des engagements réciproques entre les collaborateurs et l’entreprise.
Le Projet Humain d’une entreprise est à la fois un Cap, un Cadre et une Chemin pour les expérimentations comme pour le passage à l’échelle.
Car au-delà des outils, c’est bien la manière dont chaque entreprise conçoit le travail et les relations de travail, et reconnaît la contribution humaine qui fera la différence en termes d’innovation, de performance et d’attractivité Employeur.
IA ou pas, les fondamentaux organisationnels, RH et managériaux restent inchangés.
Sur ces sujets, vous apprécierez peut-être de poursuivre votre lecture :
Réinventer l’entreprise par le travail
Comment les entreprises peuvent se transformer en terre inconnue
Quand l’expérience collaborateur oublie le contenu du travail – Partie 1